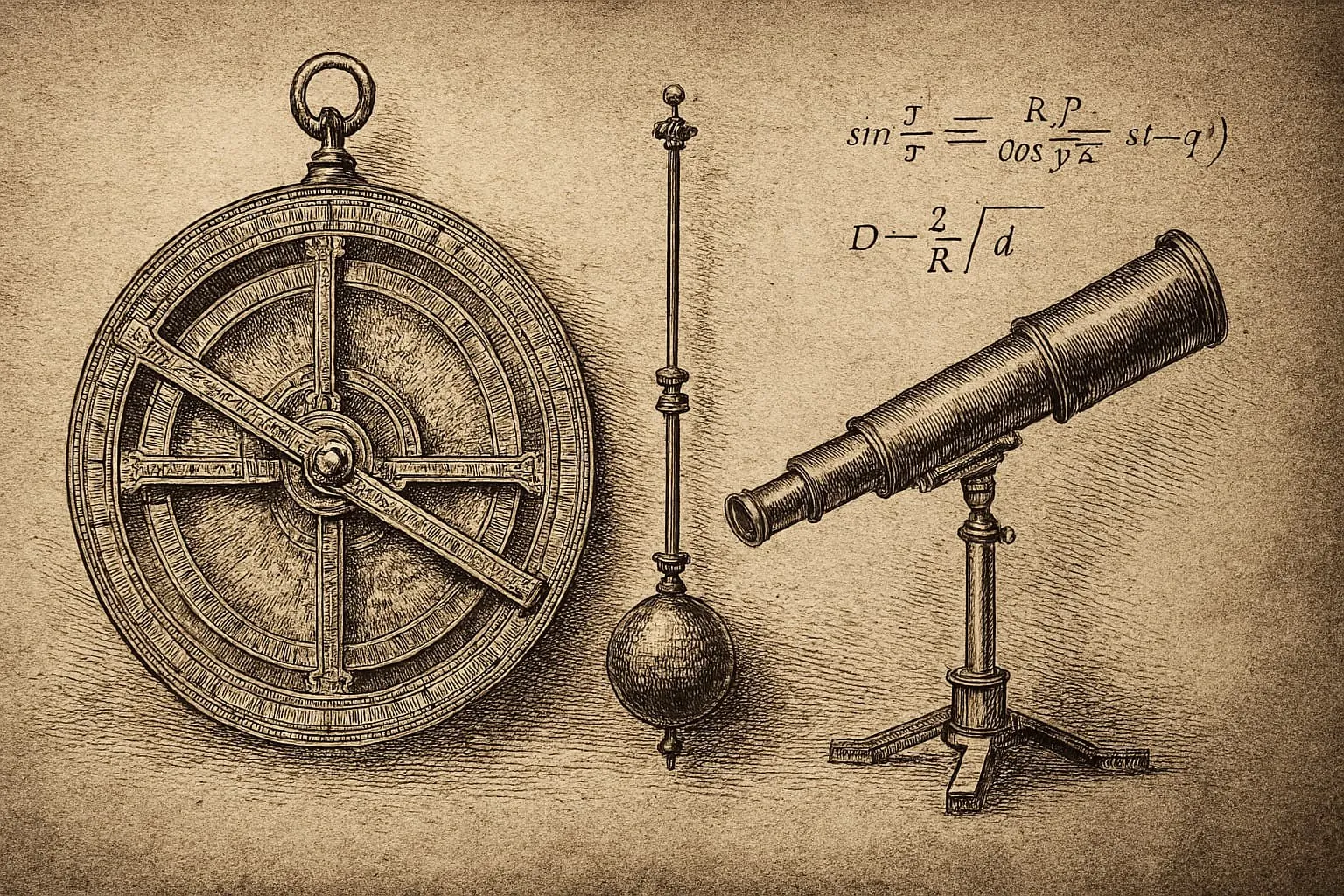
# La physique avant la quantique
Table of Contents
Avant que la mécanique quantique n’apparaisse au début du XXᵉ siècle, les physiciens disposaient d’un cadre théorique — la physique classique — qui expliquait une vaste portion des phénomènes observables. Ce cadre reposait sur des idées intuitives : trajectoires continues, cause et effet, et des lois déterministes qui prédisent comment un système évolue dans le temps.
Ce texte présente, de manière pédagogique, l’esprit du monde classique puis un petit problème simple mais décisif qui a montré ses limites et ouvert la voie à la quantique.
Le monde classique
Le monde classique, c’est celui de Newton et Maxwell. Quelques traits caractéristiques :
- Trajectoires bien définies : une balle lancée suit une trajectoire précise si l’on connaît ses conditions initiales.
- Déterminisme : connaissant l’état présent (positions et vitesses), on peut — en principe — prédire l’état futur.
- Continuité : grandeurs comme la position, la vitesse ou l’énergie varient de façon continue.
- Ondes et particules séparées : la lumière est décrite comme une onde électromagnétique (Maxwell), les masses comme des particules ponctuelles (Newton).
Ce cadre a permis des approximations remarquablement efficaces : calcul de l’orbite des planètes, propagation des ondes radio, thermodynamique classique, etc. Mais comme toute théorie, il a des domaines d’applicabilité — et des limites.
Un petit problème
Le « petit problème » que nous évoquons n’est pas une énigme philosophique mais une contradiction pratique entre théorie et expérience. Un exemple simple et révélateur est l’étude du rayonnement émis par un corps chauffé — le rayonnement du corps noir.
Selon les lois classiques de l’électromagnétisme et de la thermodynamique, un corps noir (idéal) émettrait de plus en plus d’énergie à mesure que l’on considère des longueurs d’onde de plus en plus petites. En poussant le calcul, l’énergie rayonnée diverge : on parle alors de la catastrophe ultraviolette. Autrement dit, la théorie prédit une quantité infinie d’énergie émise, ce qui est manifestement en contradiction avec les mesures.
Pour résoudre ce désaccord, Max Planck proposa en 1900 une hypothèse audacieuse et minimale : l’échange d’énergie entre la matière et le rayonnement ne se faisait pas de façon continue, mais par paquets discrets — des quanta d’énergie proportionnels à la fréquence. Cette simple idée permit de dériver la loi correcte du rayonnement du corps noir et marqua le point de départ d’une révolution plus large.
Plus généralement, d’autres expériences posaient problème pour le cadre classique : la stabilité des atomes (selon la théorie classique, un électron en orbite radierait continuellement de l’énergie et spiralerait vers le noyau) et l’effet photoélectrique (où la lumière arrache des électrons de la matière d’une façon qui dépend de la fréquence et non de l’intensité). Ces anomalies ont poussé les physiciens à repenser des notions centrales comme l’énergie, la matière et la façon dont ils interagissent.
Avant la mécanique quantique, la physique classique offrait des images simples et puissantes mais elle butait sur des expériences précises. Le « petit problème » du corps noir — et d’autres observations — a montré que le monde microscopique obéit à des règles différentes. La mécanique quantique n’est pas une simple correction technique : elle change la manière même dont on pense les états physiques, la mesure et la probabilités.
Dans un prochain article, nous verrons comment l’intuition classique a été transformée par de nouvelles idées : quantification de l’énergie, dualité onde-particule et principe d’indétermination — tout en gardant des ponts vers la description classique lorsque celle-ci redevient une bonne approximation.